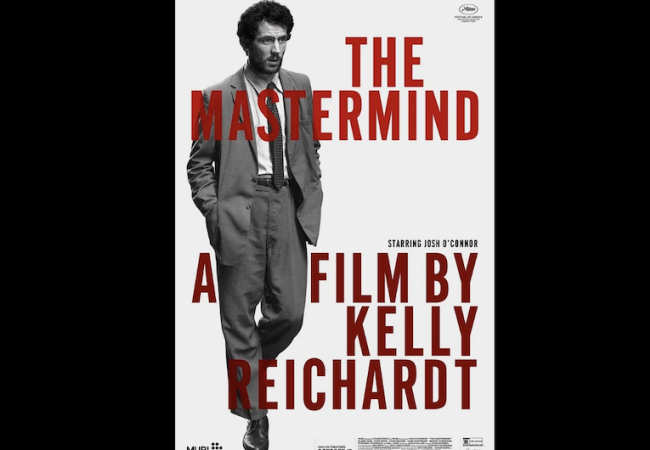Empire of Light

Mélancolique et balnéaire, "Empire of Light" met une fois de plus en évidence les qualités de cœur de Sam Mendes même si son propos, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, n'a rien à voir avec une quelconque "déclaration d'amour" au cinéma...
C'est une salle de cinéma comme on n'en fait plus: art déco décrépi, rideau de velours rouge, vendeuse de pop-corn, projectionniste vieille école... Dans le genre "ode au 7e art " façon Babylon et autres Fabelmans, peut mieux faire. C'est pourtant bien cette étrange lecture qui a primé dans la presse au sujet du nouveau film de Sam Mendes, et tant pis si l'endroit le plus secret et le plus magique de cette salle, autrement dit son dernier étage abandonné aux pigeons et à un vieux piano à queue, n'a pas grand chose à voir avec les joies du grand écran.
De fait, le bord de mer qui jouxte L'Empire -le nom de la salle- est bien plus évocateur. Nous sommes dans le sud de l'Angleterre, au début des années 80, et à ce stade, aucune "déclaration d'amour au cinéma" n'est susceptible d'alléger les tourments d'Hillary, gérante dépressive d'un établissement dont elle semble mépriser la fonction principale. Pas cinéphile pour un sou, Hillary... Pas sûr non plus que les gâteries sexuelles mécaniquement consenties à son patron (Colin Firth) lui permettent de ressentir la "magie" du 7e art et sa capacité supposée à relier les êtres entre eux. Pour l'heure, avec ou sans lithium, cette femme entre deux âges tente surtout de tanguer sans tomber.
Et pourtant, un élément nouveau dans sa vie la sort de sa léthargie. Un film ? Non, un jeune Antillais (Micheal Ward) recruté comme employé dans L'Empire. Romance aussi poignante qu'improbable, comme si cet amant d'un soir dans le pigeonnier d'un étage abandonné n'était qu'un rêve, ou alors l'un de ces châteaux de sable trop fragiles pour ne pas être furieusement démoli lorsque le réel vous rattrape... D'ailleurs, y-a-t-il vraiment romance ? Le jeune homme n'est-il pas plutôt au chevet d'Hillary au lieu d'en être passionnément amoureux ?
Même atmosphère de faux semblants (accentuée par la mise en scène veloutée et tamisée de Sam Mendes...) lorsqu'il s'agit d'évoquer le racisme dont le jeune noir est victime dans une période qui précède de peu les émeutes de Brixton. Si prenantes soient-elles, les scènes avec les skinheads ne sont propices à aucune vraie prise de conscience chez Hillary malgré son petit numéro un peu embarrassant lors de la première des Chariots de feu... Comme si, de son point de vue, c'était juste un prétexte pour à nouveau éprouver un sentiment, ou une sensation, et pour échapper à l'abîme mental qui la ronge. On en dira autant de la fameuse séquence qui, vers la fin du récit, la met exceptionnellement en joie devant un film. Là encore, c'est sa capacité de reconnexion et de "recevoir" qui est en jeu, et certainement pas une quelconque guérison, bien éphémère par ailleurs, grâce à une projection cinématographique.
Ainsi Empire of Light, via ses thèmes-leurres (le cinéma, le racisme...), nous ramène finalement à un seul sujet: c'est d'abord un magnifique portrait de femme en souvenir de la mère bipolaire du réalisateur, et avec en renfort les gouffres intérieurs de son interprète principale, Olivia Colman, dont l'art de flancher et de résister n'est plus à démontrer depuis ses performances dans The Father et The Lost Daughter. Quant au CV de Sam Mendes, il ne cesse décidément d'embellir. De American Beauty aux Noces rebelles, en passant par l'hymne pacifiste 1917, ce réalisateur britannique, tout en changeant régulièrement de style, reste fidèle à une sensibilité d'exception, qu'elle soit à hauteur d'homme ou de femme.
Empire of Light, Sam Mendes (le film est sorti le 1er mars)