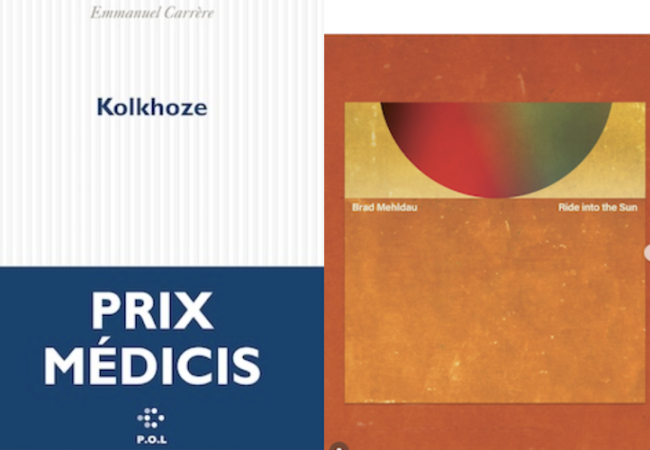Tardes de soledad

Les quelques mauvais échos rencontrés lors de la sortie en salles de "Tardes de soledad" cachaient en réalité un grand film. Au gré d'une mise en scène aux accents pasoliniens, Albert Serra désarticule puissamment le rituel masculiniste de la corrida.
"Qui nous dira à quoi ça rêve un toro dont l’œil se lève "... Les banderilles anti-corrida de Jacques Brel retrouvent une seconde jeunesse en visionnant Tardes de soledad. Son réalisateur espagnol, Albert Serra (La mort de Louis XIV, Pacifiction...), a beau ne revendiquer aucune posture morale, il lui suffit de filmer en format documentaire ce qui irrigue ses fictions -déconnexion du réel, vanité de la représentation, artifices comme artefacts du pouvoir- pour réduire en lambeaux un rituel dont sa mise en scène exacerbe avant tout la dimension spectrale.
Le sujet est en même temps ce qu'il est, mixant répulsion et lassitude face aux éternelles polémiques sur la tauromachie. On entre ainsi dans le film un peu à reculons, autant rebuté par l'esthétisation apparente du propos que par son caractère répétitif, sans oublier évidemment l'aspect éprouvant des mises à mort dans l'arène. Il en va de même pour le personnage principal, le matador Andreas Roca Rey, jeune gloire péruvienne qui ne semble guère transcender le label "beau et con à la fois" (encore une citation de Brel...) auquel il paraît prédestiné. Quelques distorsions rendent pourtant le trait plus retors: le jeune homme semble parfois ailleurs face aux blagues salaces et masculinistes de son entourage. Il lui arrive aussi de rater ses estocades jusqu'à se retrouver agrippé par le taureau, ou alors plaqué contre une paroi même s'il en ressort quasi-indemne.
Malgré tout l'attirail religieux qui entoure le personnage (une statue de Madone pleurnicharde, notamment, qui orne le petit cadre à côté de son lit...), c'est bien une désacralisation qui est à l'œuvre, à l'image d'un costume maculé de sang ou d'une séance d'habillage au forceps à l'hôtel. Il faut le soulever par les épaules, ce corps de matador, pour le faire entrer dans sa tenue. Roca Rey n'est plus dès lors qu'un mannequin de parade démonté, désarticulé. Même mouvement de décomposition dans l'arène. Serra dilate toute esquisse de chorégraphie, fragmente la gestuelle entre l'homme et le taureau jusqu'à la rendre inintelligible, étouffe l'ambiance sonore, invisibilise le public. Ses longues focales compressent l'espace, isolant et figeant encore davantage le matador dont les rictus en "cul de poule" détonnent avec la mâchoire habituellement contractée et le visage "digne" des toreros. Dans cet art ou pseudo-art de la corrida, seul le taureau au souffle amplifié paraît encore avoir une âme.
À noter aussi ce mystérieux bonhomme, mi-valet mi-manager, qui fait bande à part dans l'entourage du Péruvien. Il est quasiment silencieux tout au long du film, le visage fermé ou renfrogné. Faut-il y voir le vrai spectre de Tardes de soledad, ou alors un médium muet du jugement suspendu, même si Serra n'en pense pas moins ? La palette visuelle du film prend en tout cas elle aussi une tangente fantomatique. Le costume de Roca Rey se colore de poussière, le chatoyant pâlit, le jaune saturé du sable de l'arène devient de plus en plus terreux, se confondant avec le teint blême du torero pourtant si fringant au départ. Le sacré ou ce qu'il reste se mêle ainsi à l'archaïsme, la liturgie s'absorbe dans la barbarie. Bref, Pasolini est espagnol. Il s'appelle Albert Serra.
Tardes de soledad, Albert Serra, sorti en salles le 27 mars, actuellement sur Prime Video.