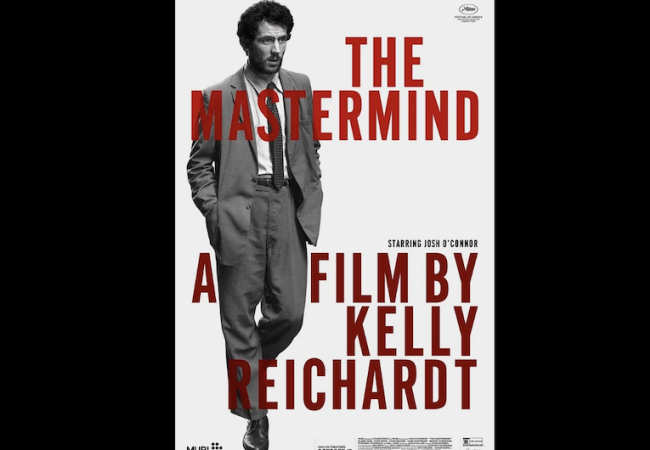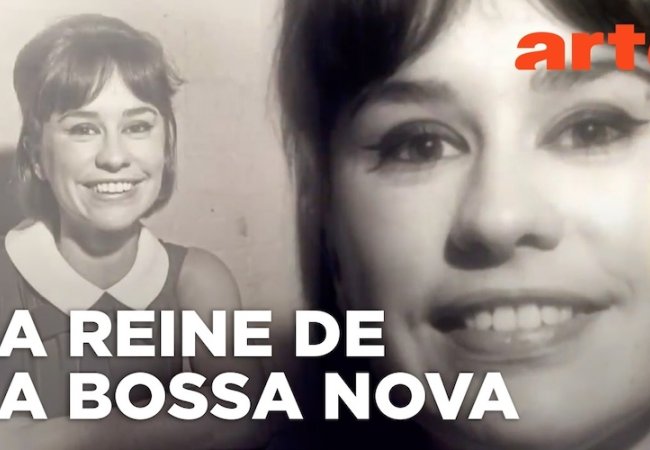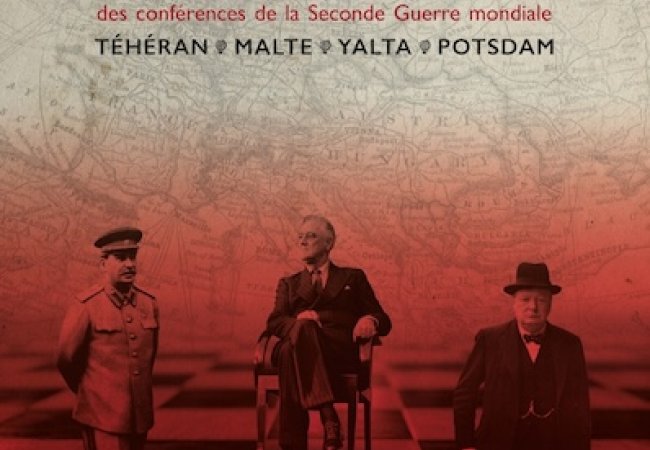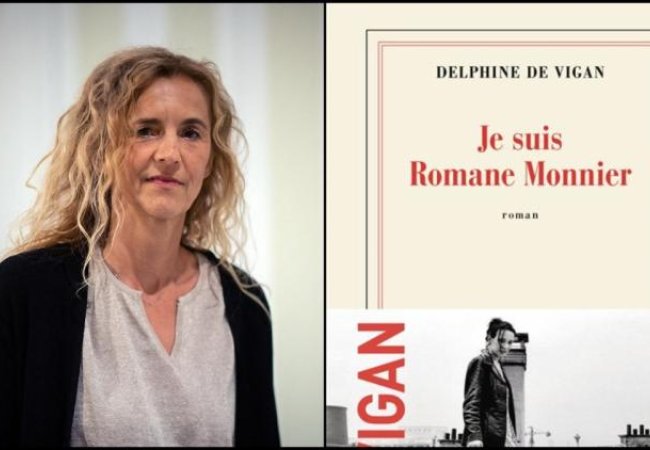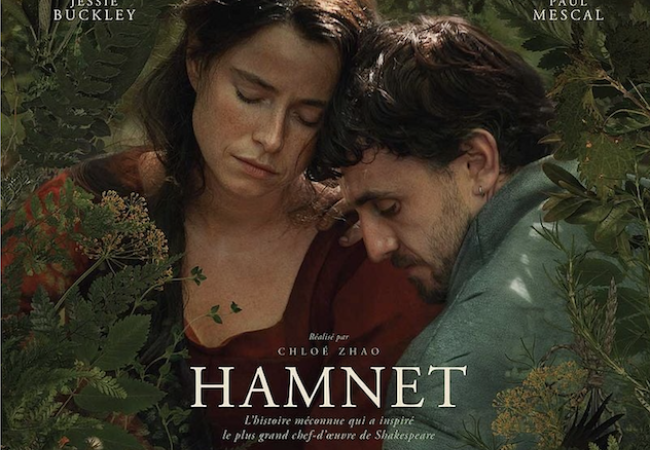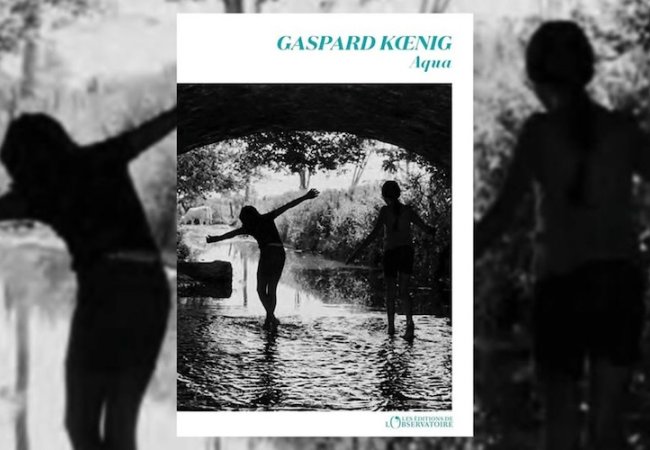Deux procureurs

Comment un procureur tout frais émoulu marche à sa perte en plein cauchemar stalinien... Annihilant les manifestations extérieures de la terreur pour la rendre plus anxiogène encore, Sergeï Loznitsa fait magistralement le trait d'union entre Kafka et Poutine.
La compétition cannoise n'était sans doute pas le cadre idéal pour accueillir le nouveau film de Sergeï Loznitsa. Au royaume des écritures virtuoses et des dramaturgies spectaculaires, sa sobriété a pu en frigorifier plus d'un. C'est pourtant, à ce jour, l'une des réalisations les plus accomplies de ce cinéaste ukrainien dont le talent s'est déjà illustré dans des documentaires d'envergure (Babi Yar. Contexte, 2022). Le retour à la fiction, via l’adaptation d’une nouvelle de Georgy Demidov, n’a pas désamorcé en tout cas la frontalité millimétrée chère à Loznitsa, et le format carré en 4/3 auquel il a recours fait immédiatement sens au regard de l’odyssée sans issue qui défile à l’écran.
Comment en serait-il autrement ? Au plus fort des purges staliniennes, en 1937, un jeune procureur (Alexandre Kouznetsov, repéré dans Leto) se jette dans la gueule du loup en trois actes. Premier signe d'inconscience, la ténacité qu'il met à rencontrer un vieux prisonnier qui a beaucoup à dire sur les sévices perpétrés par le NKVD local. L'homme a réussi à faire passer à l'extérieur un SOS rédigé avec son propre sang, mais avant d'entendre le monologue édifiant de ce bolchevik de longue date, le jeune magistrat doit prendre son mal en patience. La visite ne va pas de soi : l'administration résiste. Le détenu est malade, paraît-il, et contagieux... Dans un décor aux couleurs mates et à la géométrie asphyxiante, la mise en scène installe une terreur dépouillée de tout signe flagrant de cruauté — si ce n’est les côtes cassées et autres ecchymoses du prisonnier.
Même ambiance surréelle dans le deuxième acte. Résolu à contourner ses supérieurs directs et à rendre compte au sommet de ce qu'il a entendu, le jeune magistrat sollicite le diable en personne : Andreï Vychinski, procureur général de Staline lors des grands procès. Là encore, l'attente précédant le rendez-vous vaut oppression dans un climat où tout respire l'absurde : le secrétaire inexpressif, le type qui fait semblant de reconnaître le magistrat bien que les deux hommes ne se soient jamais vus, une autre silhouette qui demande où est la sortie alors qu'il suffit de descendre un escalier... On se croirait chez Polanski. Comment oublier également ces bureaucrates figés net au moment où le procureur idéaliste aide une secrétaire à ramasser ses feuillets ? Vychinski échappe lui aussi à sa caricature : économe de chacune de ses expressions et maniant mieux que quiconque le vocabulaire juridique, il semble prêter une attention réelle aux propos de son jeune interlocuteur, qu'il invite à poursuivre son enquête. Promis, il ne lui sera fait aucun mal...
Le troisième acte, dans le train du retour, bascule dans un décalage tout aussi kafkaïen, dont les prolongements contemporains sautent aux yeux. Pinard, guitare acoustique... La nuit stalinienne prend des formes cruellement inattendues, surtout quand Loznitsa l'ancre dans une fantasmagorie de l'âme slave déjà à l'œuvre dans Une femme douce et, plus largement, dans la grande littérature russe. C'est tout le sens d'une autre séquence ferroviaire, juste avant l'arrivée à Moscou, autour d'un vétéran unijambiste évoquant avec une mine de prophète halluciné sa rencontre passée avec Lénine. Le moment est d'autant plus spectral que le personnage est interprété par le même comédien que celui qui incarnait le prisonnier.
Deux procureurs, Sergeï Loznitsa, en compétition au dernier Festival de Cannes, sortie en salles ce 5 novembre.