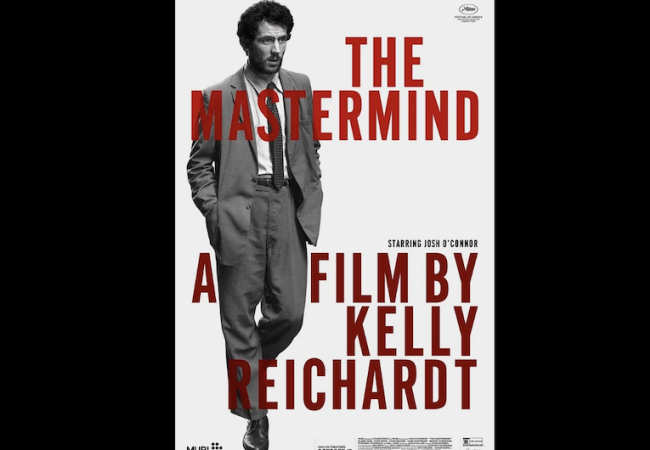Twelve Years a Slave

"Blood on the leaves and blood on the roots"... Pendu à l'arbre, il parvient à peine à toucher le sol du bout de ses orteils pour éviter la strangulation. Les autres esclaves font comme si de rien n'était, la vie de la plantation suit son cours. La caméra de Steve McQueen ne tremble pas d'un iota. Plan fixe, tétanisant, cinglant. Comme la voix de Billie Holiday dans Strange Fruit.
Froideur, dépouillement... On reconnait bien la marque de fabrique du réalisateur britannique de Shame même si la puissance de mise en scène dont fait preuve le cinéaste afro-européen se déploie, ici, dans un format moins débridé. Celui des mémoires de Solomon Northup, homme libre et fils d'affranchi dans l'Etat de New-York, soudainement transbahuté dans la solitude des champs de coton de la Nouvelle-Orléans après avoir été enlevé et vendu comme esclave, quelques années avant la guerre de Sécession. C'est évidemment cette inversion temporelle par rapport à la chronologie classique -un Noir libre sur le sol américain, puis captif- qui nous prend aux tripes.
Steve McQueen en rend d'ailleurs compte dés le premier plan: dans son cabanon d'esclave, Solomon fabrique une sorte de plume en essayant d'utiliser du jus de mûre comme encre. Ce qui le situe, d'emblée, comme un homme de culture, ainsi que l'illustre, dans une fluidité parfaite, le flashback qui suit. 12 Years a Slave prend dés lors de plus en plus d'ampleur, ne serait-ce qu'à travers l'analyse qui est faite du système esclavagiste. Les "gentils" maîtres, par exemple, se révèlent aussi barbares que les brutes épaisses. Les plus tortionnaires ont quelque chose de torturé. C'est du moins ce qui ressort du jeu saisissant de Michael Fassbender, tyran lubrique et biblique (il peut démontrer comment Jésus justifie l'esclavage...) dont l'épouse s'avère pareillement monstrueuse sous couvert de frustration conjugale et de hantise du déclassement social.
Etonnant personnage également que cette Noire mariée à un planteur blanc qui la trompe allégrement tout en lui permettant d'échapper aux coups de fouets.Le fouet, justement... Il est au coeur d'un plan-séquence pour le moins éprouvant que certains reprochent déjà à Steve McQueen. Outre le fait que ce qui est filmé a réellement existé, cet instant étiré résume pourtant au mieux le principe de dilatation d'une mise en scène qui ne cède ni au pathos, ni à l'emballement rythmique. Elle prend le temps de respirer, cette mise en scène, y compris à travers des paysages à couper le souffle faisant penser, parfois, à l'univers pictural de Terence Mallick.
Le cinéma anglo-saxon boucle ainsi de la plus époustouflante des manières une trilogie sur la traite négrière entamée l'année dernière avec Django Unchained et Lincoln. Moins stylisé et jouissif qu'un Tarentino, plus sanguin qu'un Spielberg, 12 Years a Slave impressionne à la fois par sa grandeur et son humilité, à l'instar de son interprète principal, Chiwetel Ejiofor, ou encore de ce "negro spiritual" (Roll, Jordan, Roll) entonné par les esclaves à l'enterrement de l'un des leurs. Aux antipodes de l'esbroufe et des grosses ficelles mélodramatiques, on tient là un film profondément libérateur.
12 Years a Slave, de Steve McQueen (Sortie en salles le 22 janvier). Coup de projecteur, le même jour, avec Vincent Le Leurch, journaliste au Film Français.