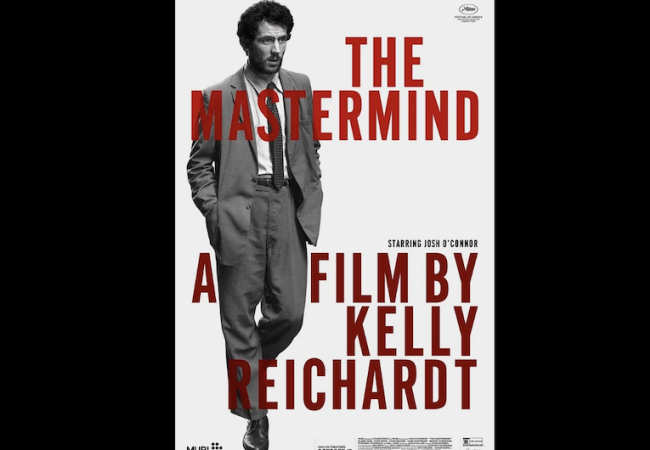Oui

Ce "Oui" à tout, y compris à ce qui avilit... À l'ombre de Gaza et de la musique de Thelonious Monk, l'Israélien Nadav Lapid signe un récit puissant, convulsif et désespérant. On n'est pas prêt de s'en remettre.
On dirait la chute de l'empire romain. À Tel Aviv, autrefois si réputée pour sa sensualité, des nantis bedonnants festoient dans la fange. Un jeune couple d'artistes anime la soirée. Ambiance lascive, obscène... Ces deux-là sont intenables. Lui, surtout, Y., un pianiste déjanté apparemment "chargé" jusqu'à plus soif. Une cuvette de sangria se présente à sa vue ? Il plonge la tête dedans, avant de se répandre tout habillé dans une piscine. Séquence d'autant plus incongrue après le 7 octobre - et alors que Gaza surgit déjà dans les smartphones. Ainsi une société perd-elle pied dans le trash et le fracas, ne serait-ce qu'au niveau sonore. À côté, La Grande Bellezza ressemble à une sonate.
De quoi réconcilier le fond et la forme chez Nadav Lapid dont les deux précédents films, Synonymes et Le Genou d'Ahed, nous apparaissaient au contraire poseurs et inutilement épileptiques. Rien de tel ici. Porté par l'effroi que charrie la période actuelle, ce réalisateur israélien et parisien d'adoption allie enfin mordant et authenticité. Dans son viseur, l'aveuglement de beaucoup de ses concitoyens face aux horreurs perpétrées par Tsahal à Gaza, telle une vengeance sans fin après les atrocités commises par le Hamas. Aveuglement auquel font écho les compromissions du personnage principal car pour Y., incarné par Ariel Bronz avec une exubérance rageuse, les lendemains de bacchanales empestent. Voilà qu'on lui commande la musique d'un vieil hymne patriotique transformé en chant génocidaire. Nausée...
L'épisode, d'ailleurs, n'a rien de fictif. Après le 7 octobre, un mouvement nationaliste, Front Civique, a sorti une nouvelle version du classique Hareut (Camaraderie) écrit par le poète Haïm Gouri, mais en y substituant de nouveaux mots. Dans le clip, des enfants appelaient à l'éradication de Gaza. Mais revenons à notre pianiste : qu'importe l'indécence du challenge, Y. est prêt à le relever. Il faut bien vivre de son art, et accessoirement payer son loyer. Lui qui vend si facilement son corps, pourquoi ne braderait-il pas également son âme, ainsi que l'avenir de son couple ? Un doute le tenaille, pourtant. Ça le ronge, ça exsude. Et puis il étouffe dans ce Tel Aviv sous stéroïdes que Lapid filme avec une frénésie et une inventivité formelle (la tronche du représentant du pouvoir "pixellisée" en direct, les gratte-ciel qui surgissent du sol avec une télécommande...) qui laissent pantois.
Ce doute, ce "Oui"... mais, la deuxième partie du récit le décline dans une tonalité tout aussi ample bien que radicalement différente de ce qui a précédé : Y. prend la direction de Gaza, comme en quête de cratère après avoir dansé sur le volcan. À moins qu'il ne veuille se rapprocher de l'enfer pour mieux "travailler" son hymne. En chemin, il croise une ex, Léah, traductrice pour le compte de l'État. Dans l'une des séquences les plus inoubliables du film et alors qu'elle est au volant, cette femme de mots se lance dans un monologue tétanisant sur les atrocités du 7 octobre. La caméra tremble alors autrement, et pas seulement en raison des cahots sur la route.
Le plus beau, c'est que même sur une gamme plus mélancolique, le film reste convulsif: d'abord en hors-champ, puis à l'écran, les anciens amants s'embrassent sur fond de ruines, en haut d'une colline qui surplombe Gaza dans son manteau de fumée noire. Du même endroit à peu près, Y. hurle les paroles de sa chanson nationaliste. La punition, biblique à souhait, ne tarde pas : une pluie de pierre envoyée par sa mère décédée lui tombe dessus. Poésie, transe, mystique, drame intime... Une œuvre totale et à rebours de tout un cinéma politique trop souvent tiédasse s'imprime dans les tréfonds de notre conscience. Nadav Lapid la ponctue aussi d'une voix off implacable : « Les Israéliens qui ont grandi avec la question : “Comment peut-on vivre normalement tout en commettant des horreurs ?” sont eux-mêmes devenus la réponse. »
Et puis il y a Thelonious Monk. C'est lui qu'on entend sur l'autoradio de Y. se dirigeant vers Gaza, battant la syncope dans cette course vers l'abîme. Monk le maudit et son jazz "sauvage", comme le dit Nadav Lapid sur notre antenne. Pour Y., jusqu'ici dépeint comme un personnage façon The Rocky Horror Picture Show (avant de dériver vers Hiroshima mon amour...), la jam session permanente n'a plus lieu d'être. Va-t-il enfin apprendre à dire "Non", à ne plus être cet aquoiboniste qui fait toujours le zouave et qui est prêt à se salir les mains plutôt que de transmettre à son enfant tout un héritage de frustrations et autres batailles perdues, à l'instar d'Antigone ou de Don Quichotte ? Car c'est bien la tragique discordance que Oui met magistralement en scène dans son bouillonnement fleuve - 2h30 au final : il n'y a plus rien de romantique dans le fait de résister, s'opposer au reste de la société, pouvoir se regarder dans une glace. C'est devenu au contraire le comble de la ringardise. Gaza, on l'aura compris, continue de questionner le genre humain.
Oui, Nadav Lapid, Quinzaine des Cinéastes à Cannes, sortie en salles ce 17 septembre. Coup de projecteur sur TSFJAZZ le même jour (13h30) avec le réalisateur.