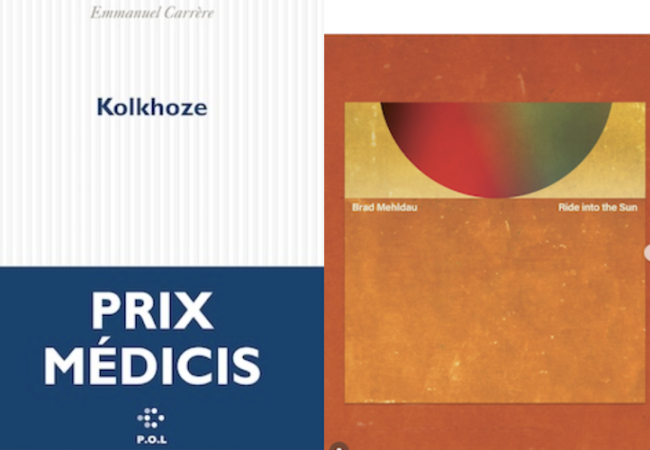Vichy: histoire d'une dictature (1940-1944)
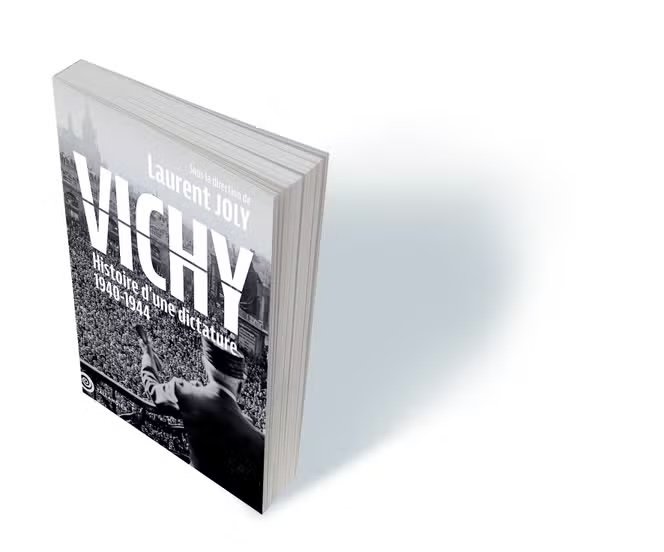
Laval encore plus infect qu’on ne l’imaginait, même topo pour Darlan malgré ce que certains ont pu dire, le trauma du STO… Ambitions, fuites en avant, mais aussi coups de frein sous la pression de l’opinion car même sous une dictature, l'opinion compte... Vous pensiez connaître Vichy par cœur ? Lisez l'implacable "Vichy: histoire d'une dictature 1940-1944", qui réunit onze chercheurs sous la direction de Laurent Joly, que TSFJAZZ a interviewé.
– Ce livre est-il une mise à jour ou une mise au point ?
Les deux. Une mise à jour parce que les connaissances ont progressé, mais aussi une mise au point, car beaucoup d’éléments demeurent mal compris. Pour les spécialistes, la nature du régime est claire, mais pour le grand public, elle reste floue. On parle souvent de « régime autoritaire », or cette notion ne fonctionne pas pour Vichy. Aujourd’hui, certaines démocraties restreignent les libertés tout en conservant leurs institutions ; ce ne sont pas des dictatures. Vichy, si : la démocratie y a été détruite du jour au lendemain. Plus de Parlement, de presse libre, de droit de manifester... On a assisté à une destruction totale, soudaine de la démocratie, remplacée par une dictature incarnée par un homme, le maréchal Pétain, qui, par un coup d’État légal les 11 et 12 juillet 1940, s'octroie les pleins pouvoirs effectifs et désigne son successeur : Pierre Laval.
– Parler de dictature, c’est aussi dire que Vichy n’a pas été une administration passagère…
Oui, le régime n’a duré que quatre ans, mais il s’est projeté dans la durée. Pétain, Laval, Darlan ou Bousquet pensaient que l’Allemagne allait dominer l’Europe pour longtemps et que la démocratie libérale était morte. Leur projet était de refonder durablement la France dans ce nouvel environnement. C’est ce qui rend Vichy si troublant : un régime à la fois éphémère et porteur d’une vision du monde. Après la défaite de 1940, on aurait pu imaginer un gouvernement en exil, comme les Néerlandais ou les Belges. À la place, des hommes dotés d’une légitimité antérieure ont choisi de renverser la République. La France est la seule nation vaincue à l’avoir fait. Cette rupture, portée par des courants antidémocratiques déjà anciens et par le fait qu'il y avait à Londres une autre autorité française incarnée par le général de Gaulle, a ouvert une fracture politique qui, à mon sens, pèse encore sur notre histoire.
– L’ouvrage évoque aussi une collaboration militaire. C’est nouveau ?
Oui. C’est l’un des apports du chapitre rédigé par Bernard Costagliola, spécialiste de Darlan. On découvre qu’il y a eu collaboration militaire effective entre Vichy et le Reich, notamment en Syrie et dans les territoires de l’Empire, où des soldats français ont tiré sur d’autres Français. Officiellement, Vichy prônait la neutralité ; en réalité, il a cherché à négocier une place dans le futur ordre européen, mais sans jamais avoir de réponse d'Hitler. Le gouvernement français a ainsi été stoppé dans cette dynamique faute de contrepartie allemande.
– C’est pour cette raison que Vichy n’a jamais déclaré la guerre à l’Angleterre ?
En partie. Il y a eu aussi la promesse initiale faite aux Français : "Je vous sors de la guerre." C’était le sens de l’Armistice. Replonger dans le conflit aurait brisé cette promesse et ruiné la légitimité de Pétain. Même Laval, qui rêvait d’une entente avec l’Allemagne, n’a jamais osé aller jusque-là. Cela n’empêche pas qu’il y ait eu une collaboration militaire et qu’avec Darlan, on ait frôlé le renversement des alliances.
– Votre livre donne aussi à lire des journaux intimes. Pourquoi ce choix ?
Nous voulions éviter un récit cantonné aux hautes sphères de Vichy. En parallèle des grands acteurs, cinq témoins traversent le livre : le ténor du barreau Maurice Garçon, l’écrivain Paul Morand, un pasteur, une photographe et un autre écrivain. Tous ont tenu leur journal pendant la guerre ; aucun texte n’a été retouché, certains étaient restés dans des greniers. Ils permettent d’entendre ce que pensaient les Français, leurs voisins, leur concierge. Ces voix donnent au livre une unité de ton même si nous sommes onze auteurs différents : elles relient le sommet de l’État à la société ordinaire.
– Y avait-il aussi une volonté de décentrer le regard par rapport au crime antisémite, le « crime absolu » de Vichy ?
C’est le crime central, en effet, mais il faut le replacer dans l’ensemble du système. Il faut aussi rappeler que même dans La France de Vichy, Robert Paxton n’y consacrait que quelques pages ; ici, c’est une part essentielle. On ne peut pas réduire Vichy à ce seul aspect, mais c’est celui qui le juge le mieux. Vichy a été répressif, mais surtout par délégation : 18 condamnations à mort prononcées par les tribunaux spéciaux de Vichy d'un côté, contre 3000 par les tribunaux militaires allemands, mais à côté, par la déportation, le régime a livré des gens à la mort en sachant qu’ils allaient mourir, tout en refusant de le voir. Laval ne voulait pas être confronté à la mort ; il préférait qu’elle se passe loin, dans les wagons et les camps. C’est cette lâcheté, ce déni, qui caractérise le crime de Vichy.
– Le chapitre sur le STO (le travail obligatoire) est aussi saisissant. Que montre-t-il ?
On croyait qu’après novembre 1942 — débarquement allié en Afrique du Nord, invasion de la zone libre —, Vichy n’était plus qu’un régime fantoche. En réalité, les travaux de Raphaël Spina montrent une fuite en avant collaborationniste. Laval devient de plus en plus violent à la radio, et l’administration atteint une efficacité redoutable : début 1943, les quotas de travailleurs livrés à l’Allemagne sont remplis à 100 %, encore à 80 % en juin. Vichy demeure un partenaire fiable pour l’occupant jusqu’à l’été 1943.
– C’est là que Laval dit « non » pour la première fois…
C’est un non opportuniste. En août 1943, il renonce à livrer les juifs naturalisés après les années trente, qu’il avait promis aux Allemands : "Je ne peux pas". Même Bousquet rechigne. La désobéissance s'étend dans l'administration et dans la population. Le chiffre des réfractaires au STO explose. L’été 1943, c’est vraiment le grand tournant : l’Italie fait défection, la Résistance s’organise, et Vichy se fissure. C'est là qu'on peut vraiment parler d'État fantoche. Les Allemands imposent alors Joseph Darnand, chef de la Milice, à la tête de toutes les polices. Vichy n’est plus complice ou co-décisionnaire, comme en 1942, mais seulement un exécutant sans autonomie, dont les initiatives sont criminelles.
– Cette somme paraît alors que débutent les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, dont le thème est « La France ? ». Que vous inspire ce point d’interrogation ?
Il est salutaire. L’histoire récente de la France est marquée par Vichy. C’est une ombre portée : la République d’après 1944 s’est construite en opposition à cette dictature. L’extrême droite était discréditée, et si la droite s’est régénérée, c’est grâce au gaullisme et à la démocratie chrétienne. Depuis, au niveau national, la France n'a plus jamais connu l’extrême droite au pouvoir, ni d’alliance droite-extrême droite. Aujourd’hui, cet équilibre est fragile. On sent qu'on est à un point de basculement. Si l’on veut réfléchir à la crise politique que nous traversons, il faut quelques repères historiques — et Vichy est l’un d’eux.
Vichy: histoire d'une dictature (1940-1944). Sous la direction de Laurent Joly (Editions Tallandier)