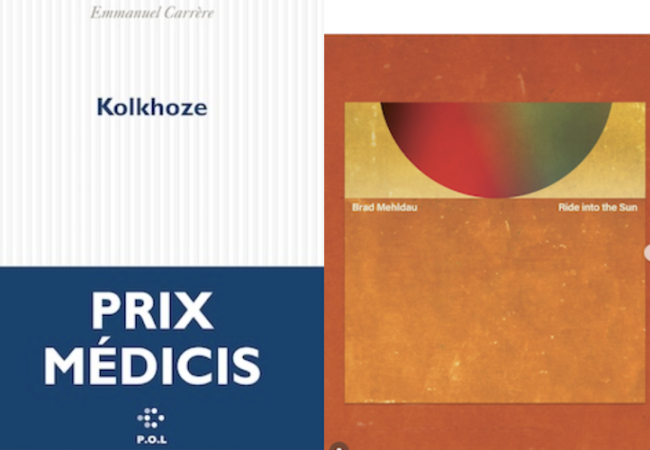Adolescence

Autopsie d'un crime, ou plutôt du chaos qu'il génère à travers quatre plans-séquences... La mini-série britannique "Adolescence" proposée actuellement par Netflix ne laisse pas indemne, même si le dernier épisode gâche un peu l'ensemble.
Avant de dégringoler de haut, et même de très haut au regard de son catastrophique dernier épisode, Adolescence s'impose comme la vision coup-de-poing d'une génération perdue et d'adultes désemparés. Avec pour point de départ le crime perpétré par un adolescent dans la banlieue de Sheffield, cette mini-série se déploie à travers différentes mises sous tension dans des espaces et des temporalités spécifiques. Seul dénominateur commun, et il est implacable: le recours au plan-séquence sur toute la durée de l'épisode. Ainsi dépourvue de plan de coupe ou de champ/contrechamp, la mise en scène signée Philip Barantini favorise une immersion de plus en plus glaçante qui va de pair avec une acuité remarquable dans l'observation d'un chaos à la fois familial et sociétal.
Le premier segment donne le ton. Jamie, 13 ans, mouille son pyjama lorsque la police fait irruption dans sa chambre après l'attaque au poignard ayant coûté la vie à une fille qui faisait partie de ses fréquentations scolaires. Toutes les étapes de sa garde à vue, jusqu'au moindre détail procédural, sont filmées au scalpel sous le regard d'abord attentionné puis désemparé de son père (Stephen Graham, également coauteur de la série...), notamment lorsque ce dernier comprend que son fiston n'est pas aussi innocent qu'il l'affirme.
À peine prend-on le temps de se questionner sur le profil de ce père au regard des actes reprochés à son fiston que l'apocalypse change de dimension. Nous voici dans le collège où étudiaient la victime et son meurtrier. Un collège, ou plutôt un labyrinthe d'insociabilités en tous genre. Confrontés à des profs débordés, des jeunes dopés à leur Instagram et autres meutes lancés à la chasse aux "incels" ("célibataire involontaire") sur l'autel d'un masculinisme destructeur, les deux flics en charge de l'affaire semblent se cogner à toutes les portes. Un sublime mouvement conclut ce 2e épisode lorsque sur l'air de Fragile, de Sting, la caméra survole la ville avant de retrouver le personnage du père qui dépose un bouquet de fleurs sur l'emplacement dédié à la victime.
Le troisième plan-séquence est sans doute le plus impressionnant. Dans le centre de détention où il a été placé dans l'attente de son procès, Jamie est confronté à une psy chargée d'évaluer son discernement. Enrobé dans une dramaturgie à couper le souffle, l'échange -ou plutôt le match- est rythmé par la pluie à l'extérieur et les montées d'adrénaline du gamin dès lors que la psy parvient à le déconstruire et à lui arracher quelques bribes sur ce qui le rendait si amer envers sa victime. Owen Cooper, qui joue Jamie, donne alors la pleine mesure de son jeu face à une Erin Doherty toute aussi phénoménale dans la peau de cette psy à la fois investie dans sa pratique professionnelle et ébranlée par les accidents de comportement qu'elle génère.
On comprend d'autant moins la portée du quatrième et dernier épisode, centré sur la résilience de la famille de Jamie plusieurs mois après le drame. Soudés entre eux alors qu'on les montre encore du doigt dans leur environnement immédiat, le père, son épouse et leur fille tentent de garder le sourire malgré le trauma persistant. Une longue scène qui vire karaoké dans une camionnette interpelle encore davantage avant que le propos ne se noie dans le pathos. Il fallait faire contrepoint, paraît-il, au caractère clinique des trois épisodes précédents. Un contrepoint ? Mais n'est-ce pas là tout le contraire d'un plan-séquence ?
Adolescence, Philip Barantini (actuellement sur Netflix)