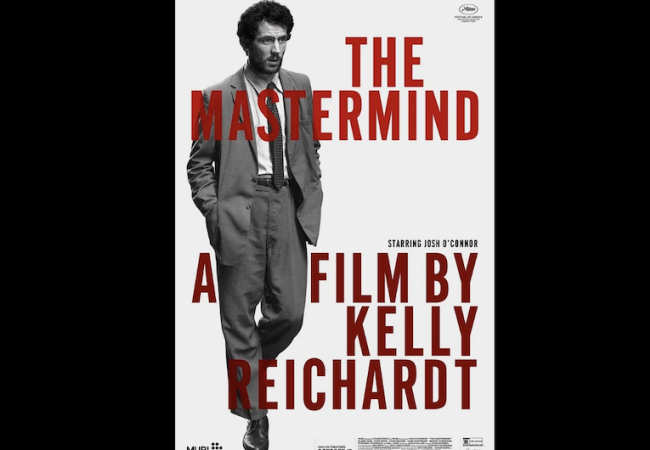The Brutalist

Avec ampleur et densité mais sans la moindre esbroufe de mise en scène, "The Brutalist" offre à Adrian Brody le rôle marquant d'un architecte juif hongrois à l'âme disloquée, tel un échafaudage qui s'est effondré.
Tout est affaire de dimensions dans The Brutalist : son propos architectural, sa durée de 3h30, ses thématiques multiples ou encore son format atypique, le VistaVision, un vieux procédé d'écran large conçu autrefois comme une réponse au CinémaScope. Tout est affaire de dimensions, y compris dans la façon avec laquelle un quasi-inconnu au bataillon, le réalisateur et acteur américain Brady Corbet, se montre largement à la hauteur de ses ambitions.
Son principal atout ? Une puissance narrative qui captive d'un bout à l'autre jusqu'à intégrer judicieusement un entracte dans son récit. Pas besoin pour cela de montrer ses muscles à travers tel ou tel morceau de bravoure propre à certains films à gros budget. C'est une fresque à taille humaine que Brady Corbet met en scène, ne s'autorisant comme seul "exploit" un magistral plan-séquence d'ouverture qui voit Adrian Brody, alias László Toth, errer dans on ne sait quelle pénombre parmi d'autres gens avant de surgir de l'entrepont d'un paquebot accostant dans le port de New York. Derrière lui, la Shoah à laquelle il a survécu. Devant, la statue de la Liberté filmée cependant de travers, et même à l'envers, comme pour mieux suggérer ce que la trame à venir, derrière son vernis monumental, aura d'abord d'oblique, de décalé et de dissonant.
Ainsi en advient-il du rêve américain de László Toth, architecte juif hongrois émigré en Pennsylvanie en 1947 et dont la reconstruction, sur le plan professionnel comme à un niveau plus intime, vire au parcours du combattant. Entre dépendance à la drogue, soupe populaire et racisme, sa rencontre avec un millionnaire (Guy Pearce) qui lui commande la réalisation d'un bâtiment moderniste en haut d'une colline augure semble-t-il d'une vie meilleure, sauf que derrière le magnat généreux bien qu'un peu lunatique se cache un mécène aussi dépravé que son fils, lequel ne peut résister à lâcher "Nous vous tolérons..." en direction du héros. Le décor se lézarde un peu plus lorsque l'architecte fait venir aux États-Unis sa femme et sa nièce. La première est paralysée. La seconde, apparemment muette...
À l'odyssée d'un capitalisme féroce emblématisé par le "brutalisme", ce style architectural qui ne jurait à l'époque que par le béton et l'acier, se superposent les conséquences du trauma de la Shoah. Tout un échafaudage de l'âme s'est effondré chez László, jusqu'à miner sa sexualité, son intégrité et son art. Sans même nécessiter un épilogue un peu tiré par les cheveux qui fait le trait d'union entre ses travaux et l'architecture des camps, le film expose avec intensité ce "brutalisme" de l'Histoire. La composition d'Adrian Brody, bien moins misérabiliste que dans Le Pianiste, en traduit également toutes les ambivalences et les fissures de fragilité dans le marbre.
Comme dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, autre fresque bâtie dans le dur, The Brutalist bénéficie d'une maîtrise formelle impressionnante. Chantier de construction, intérieurs bourgeois, club de jazz, carrières italiennes... Quel qu'en soit le cadre, la photographie de Lol Crawley fait des merveilles, tout comme la B.O à la fois percussive et bruitiste de Daniel Blumberg avec son piano préparé et ses cuivres foisonnants. De quoi donner encore plus de souffle à cette épopée en sourdine.
The Brutalist, Brady Corbet (Sortie en salles ce mercredi 12 février)