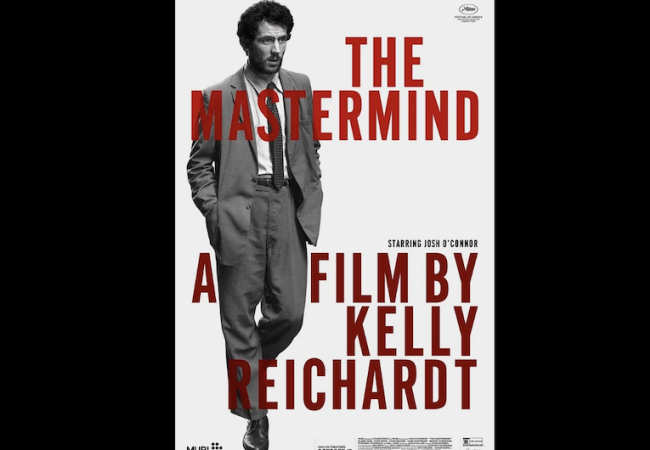Neruda/Jackie

Ce début d'année 2017 sera son épiphanie. Déjà repéré dans le passé avec No et El Club, le Chilien Pablo Larrain embarque à présent, et à quelques semaines d'intervalle, Pablo Neruda et Jackie Kennedy dans le maelström d'une écriture cinématographique hors-du-commun.
Honneur, tout d'abord, au héros national. Arrachant Neruda à sa glorification posthume suite au putsch de Pinochet, Pablo Larrain éclaire un épisode méconnu dans la vie du poète chilien, à savoir son passage dans la clandestinité, en 1948, lorsque ses idées communistes l'exposaient déjà aux foudres du pouvoir. Drôle de fugitif ! Veut-il vraiment échapper à ses poursuivants et ces derniers ont-ils franchement envie de le capturer ? Drôle de coco, surtout ! À l'instar du formidable Dalton Trumbo sorti l'an passé, Neruda met en scène un homme solide dans ses convictions mais ambivalent dans son mode de vie. Proche du peuple, certes, mais encore plus proche des prostituées qu'il fréquente assidument. Luxe, luxure...
Campé par un Luis Gnecco tout en rondeurs roublardes, Neruda n'a rien d'un surhomme, ce qui d'évidence le rend encore plus humain. Surtout aux yeux du Javert lancé à ses trousses et qui cède peu à peu à la fascination que sa sa proie exerce sur lui. À tel point qu'on se demande si ce flic fascistoïde, dans une configuration-miroir à la Borges, ne serait pas la création fictive de Neruda. Ce dernier, à vrai dire, ne cesse de tisser en démiurge le culte qu'il entretient de lui-même. Jusqu'à poser en Néron décadent dans l'une des séquences les plus sidérantes du film.
Une mise en scène baroque fait écho à cette vision iconoclaste. Des sénateurs qui s'invectivent dans une pissotière, une même conversation découpée en plusieurs lieux, un parfum de film noir à l'ancienne ponctué par l'épilogue glacé de la Cordillère des Andes... Entre jeux de reflets, couleurs contaminantes et climat crépusculaire, Neruda n'est pas sans rappeler Le Conformiste de Bertolucci.
Tout comme Neruda, Jackie Kennedy façonne une mythologie. La sienne comme celle de son mari. "Il n'y aura jamais un autre Camelot", confesse-t-elle au journaliste de Life qui l'interviewe peu de temps après l'assassinat de JFK, en référence à un spectacle sur le roi Arthur dont le couple présidentiel était fan. Et lorsqu'il s'agit d'imaginer la plus émouvante des processions, c'est une autre référence, celle des funérailles de Lincoln, que la First Lady endeuillée impose, mettant les services de sécurité sur les dents. Avec plus de panache encore que dans Neruda (peut-être grâce à la rage poignante de Natalie Portman), Pablo Larrain orchestre une partition stridente autour de la veuve la plus glamour de l'histoire des Etats-Unis.
Focalisant, justement, sur l'après-Dallas, il joue sur les éclats, les brisures, les fragments... Fragments d'un crâne transformant un tailleur Chanel rose en suaire rouge-sang, ce 22 novembre 1963. Fragments de mémoire avec, pour leitmotiv obsédant, des fausses images d'archives en noir et blanc (ou plutôt des vraies, à ceci près que c'est Portman qu'on voit à l'écran en lieu et place de la vraie Jackie Kennedy...) qui montrent la First Lady en train de faire visiter la Maison-Blanche à des journalistes avant que le conte de fée ne vire au cauchemar américain.
Les amateurs d'hagiographies mainstream, lisses et compactées en seront pour leurs frais. Dans Neruda comme dans Jackie, l'identité est multiple, irréductible à tout formatage, infiniment mystérieuse. Plus que le biopic, c'est l'antibiopic qui fait des merveilles. Sur ce type d'exercice où le 7e art s'invente de nouvelles libertés, Pablo Larrain s'impose déjà comme un pionnier.
Neruda et Jackie, de Pablo Larrain, sortie en salles le 4 janvier et le 1er février.