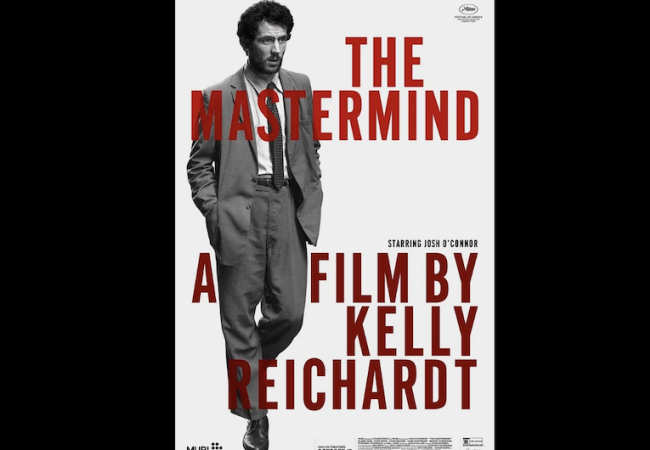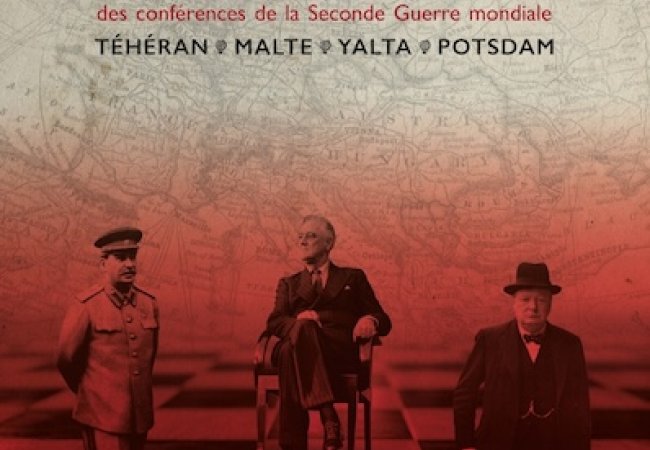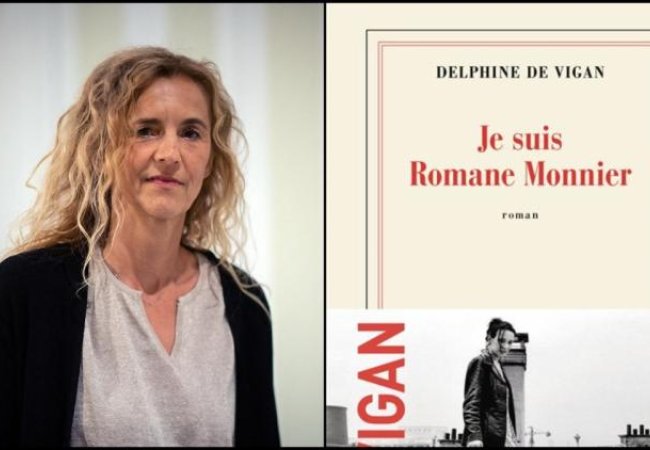Megalopolis

Après avoir fait disjoncter le Festival de Cannes, le péplum rétro-futuriste de Francis Ford Coppola débarque sur nos écrans. Résultat: un ovni baroque dont les capacités d'ensorcellement transcendent ce que le propos peut avoir parfois d'édifiant.
Comparaison n'est pas raison. Entre ville-kaléidoscope, capharnaüm urbain, parc d'attractions et bac à sable de toutes les fantasmagories imaginables, Mégalopolis n'a pas du tout la même texture que le Las Vegas liquéfié en strass et paillettes que Coppola avait recréé dans Coup de cœur. Les détracteurs du cinéaste -et ils ont été nombreux à Cannes- se sont plu à mettre en parallèle les deux cités dorées en les accompagnant d'adjectifs assassins: creux, vide, grandiloquent... La New Rome relookée en Manhattan de Mégalopolis, si trépidante et munificente, même dans ses versants "vintage", vibre pourtant de façon autrement plus déjantée.
Un architecte un peu fou la contemple de haut, comme les anges empêchés au début des Ailes du désir (voilà pour la patte "vintage"). Campé par Adam Driver, ce démiurge prénommé César manie au sens littéral du terme l'art du temps suspendu. Sa devise ? "Time, stop ! "... Sa potion magique ? Le Mégalon, un mystérieux matériau encore plus résistant que le béton grâce auquel il entend créer une ville entière. Ses ennemis ? Ils sont nombreux: un maire (Giancarlo Esposito) briseur de rêves vacciné a fortiori contre toute folie des grandeurs, un grand-oncle banquier (John Voight) vérolé de cynisme auquel s'est acoquiné une jeune journaliste particulièrement vénale (Aubrey Plaza), ou encore un cousin (Shia LaBeouf) aussi dépravé qu'ambitieux, façon Donald Trump.
Lancé à toute allure, le grand huit dans lequel ont embarqué tous ces passagers regorge de sortilèges auxquels le 7e art nous a rarement habitués: des bras qui s'ouvrent sur une enseigne lumineuse, une rivière de diamants en guise d'instrument hypnotique, un solo de batterie au milieu d'une conspiration politique... Les personnages se mettent eux-mêmes en scène, comme l'observe judicieusement Josué Morel dans Critikat, démultipliant ainsi l'autoportrait que Coppola semblait au départ ne déléguer qu'au personnage de César. Le critique y voit même un épiphanie free jazz, même si on retient surtout le moment un peu plus léger autour de Dinah Washington et son célèbre What a Difference a Day Makes.
La capacité à digérer tout cela, en revanche, reste en pointillés. Faut-il inévitablement une seconde ou troisième vision pour décrypter tout ce que Coppola a fait germer devant sa caméra, jusqu'à renoncer aux charmes ataviques du "one shot" en salle obscure ? Les versants parfois puérils ou pontifiants du propos, notamment lorsqu'il s'agit de ponctuer le déclin de l'empire états-unien dans le pain, le dollar et les jeux, ne feraient-ils office que de dégâts collatéraux d'une œuvre-monde à ce point dantesque ? On est sincèrement bien en peine de se prononcer définitivement sur le sujet. Megalopolis est à la fois le rêve fou d'un sorcier et le testament souvent mélancolique d'un immense cinéaste qui a misé toute une partie de sa vie sur ce film, comme autrefois avec Apocalypse Now. Dinguerie parmi d'autres, le crash d'un satellite et les ombres de ses victimes sur les buildings ont presque valeur de métaphore: si le film est une "cata", comme on dit trivialement, c'est une "cata" prodigieuse.
Megalopolis, Francis Ford Coppola (sortie en salles ce mercredi)