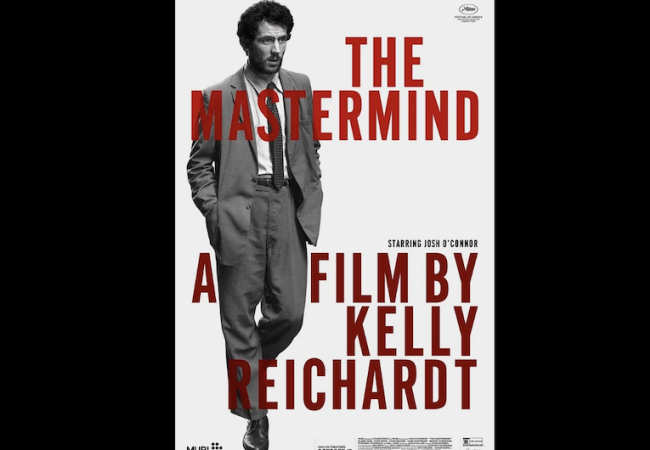Burning

Ultra coté depuis Secret Sunshine et Poetry, le Sud-Coréen Lee Chang-dong a encore gagné du galon lors du dernier festival de Cannes avec Burning, adaptation d'une nouvelle d'Haruki Murakami publiée en 2008 dans le recueil L'éléphant s'évapore. Seul le jury a résisté à l'enthousiasme critique, ce qui paraît difficilement compréhensible même si le passage du livre à l'écran n'est pas sans soulever quelques interrogations.
Dans l'art de prendre ses marques, le réalisateur a d'abord modifié le profil du personnage principal: non plus un romancier marié, comme dans le récit de l'écrivain japonais, mais un jeune apprenti écrivain nimbé d'humilité et qui vivote entre la ferme de son père et un job de coursier. Les deux autres protagonistes, eux, ont les mêmes contours que chez Murakami: une jeune femme séduisante versée dans la pantomime -la voir faire semblant d'éplucher une mandarine confine au summum de l'érotisme- et son petit ami, Gatsby imperturbable dont le passe-temps consiste à brûler non plus des granges mais des serres en plastique qu'il juge inutiles.
Le texte de Murakami fait à peine 25 pages, Burning s'étend sur près de 2h30. Lee Chang-dong en respecte l'esprit, le mystère et la densité. Y compris lorsqu'il ose une mémorable séquence "jazz-sunrise" où la fille danse seins nus au soleil couchant, entre deux joints de marijuana partagés avec son Jules et son Jim, le tout sur la musique d'Ascenseur pour l'Échafaud. Qu'importe si dans la nouvelle de départ c'est un autre morceau de Miles Davis, Airegin, qui est cité.
Là où le bât blesse, c'est que ce personnage féminin n'a pas tout à fait le même statut que chez Murakami. Craquante au départ, elle vire quelque peu pimbêche au moment même où Lee Chang-dong fait de sa disparition mystérieuse l'axe central du récit. Difficile, dés lors, d'adhérer au stress de son soupirant désemparé alors que dans la nouvelle de Murakami, l'évaporation de la jeune fille n'est évoquée qu'à la fin, et de manière succincte. L'auteur japonais aura en même temps pris soin de nous la rendre plus attachante que dans Burning, ne serait-ce qu'au travers de cette notation sur sa "simplicité innocente et naturelle qui attirait une certaine sorte d'hommes vers elle. Ils se mettaient aussitôt à y appliquer des émotions complexes qui en fait n'appartenaient qu'à eux."
Sauf que les "émotions complexes" que met en scène Lee Chang-dong relèvent d'un paradigme plus fourre-tout. Estropié psychologiquement et socialement, le personnage masculin se perd dans ses propres hallucinations. Un chat qu'on ne voit jamais, un puits qui n'a peut-être jamais existé... Au gré de plans séquences impressionnants de par leur rigueur hypnotique, Burning excelle de puissance dans le registre du thriller sinueux et métaphysique, mais on se prend à regretter la concision d'un Murakami. Ne pas combler les pointillés, c'est tout un art. Les multiplier, cela peut rebuter.
Burning, Lee Chang-dong, Cannes 2018 (Sortie en salles ce 29 août)